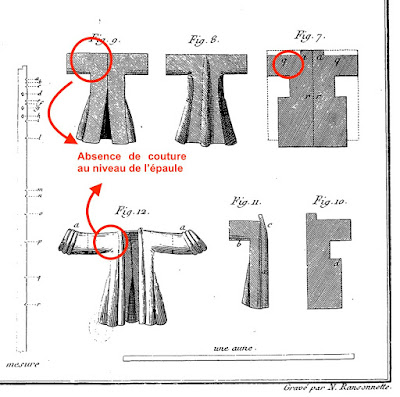Comme je l'ai écrit dans mon dernier billet, je travaille actuellement sur des chemises 18ième siècle.
À la lecture de l'Art de la lingère de Garsault paru en 1771 disponible sur Gallica, j'ai été intriguée par la couture rabattue par laquelle la chemise doit être assemblée. J'étais aussi légèrement confuse par la description du patron de La Fleur de Lyse, j'ai alors voulu vérifier comment elle était décrite originalement dans Garsault.
J'ai transcrit ici le texte original (il se peut que j'aille corrigé en français moderne certains mots durant la transcription):
''La couture
rabattue se fait de plusieurs manières; il s’en fait à surjet, d’autres à
points-devant mêlés d’arrière-points, le tout pour joindre deux pièces dont
l’une et l’autre sont sans lisières; ou bien quand il n’y a qu’une lisière à
l’une des deux pièces : car deux lisières qui se joignent l’une à l’autre
sans avoir besoin de couture rabattue à l’envers, qui ne sert qu’à empêcher les
toiles de s’effiler : voici la manœuvre.
Remployez
le bord de chaque toile, mais l’une plus que l’autre; approchez-les de leur remplis,
de façon que le rempli de l’une dépasse celui de l’autre de quelques lignes;
surjettez-les près du haut de chaque rempli; puis retournant les pièces et déployant les deux toiles, vous
retrouverez l’extrémité de chaque ploiement; vous verserez le plus long sur
l’autre, et les applatissant sur la toile, vous les y arrêterez à points de
côté; ou bien approchez l’un de l’autre les bords de chaque pièces pliés comme
ci-dessus, mais de façon que, Fig. 1G, le bord a dépasse de quelques lignes le
bord bb de l’autre; puis le long dudit bord bb, le plus bas, faite une couture
à points-devant et arrière-points d; par exemple, successivement deux points
devant et deux arrières-points. Vous rebatterez ensuite, Fig.M, le bord
dépassant aa, Fig 1G, l’autre morceau par-dessus cette couture et vous
l’arrêterez à points de côté.
Les figures
G N M, font voir une couture rabattue à points-devant mêlé d’arrières-points au
lieu du surjet.
La figure
H, Montre les deux pièces ouvertes l’envers en dessous : la couture paroît
à peine en dd; car si bien exécutée, à peine doit-on voir la couture à
l’endroit.''
Si le premier paragraphe est facile à comprendre (je ne ferais pas de résumé), j'ai eu de la difficulté avec le second.
Si j'ai bien compris pour faire la couture rabattue, il faut:
- Coudre avec un point de couture arrière (surjet) ou point devant mêlé de point arrière les deux lisières de tissus de façon à ce que la valeur de couture d'une lisière soit un peu plus longue que l'autre.
- Replier la longue valeur de couture par dessus la courte valeur de couture à la manière d'un ourlet de façon à ce que le bord de cet ourlet soit au niveau de la couture 1.
- Coudre à point de côté l'ourlet ainsi formé en prenant soin de ne pas dépasser la couture 1 de façon à ce que cette couture soit invisible du côté d'apparat de la couture.
Avez-vous envie d'essayer la couture rabattue dans un projet de couture?
Mlle Canadienne